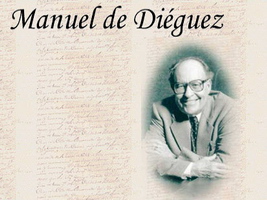|
5.
La scission de l'identité du sujet
Mais une entreprise de médiation aussi considérable allait inévitablement rencontrer toutes les
de la philosophie depuis
;
et, d'abord, l'impossibilité, pour la pensée, de jamais raccorder l'universel au singulier de manière satisfaisante, puisque l'universel
est la boîte de Pandore d'où l'intelligence, armée de l'idée, ne cesse de s'élancer vers une identité insaisissable de l'humanité.
Cependant, il n'était plus possible, à la fin du monde antique, de faire passer à la trappe le symbole de la transcendance de la personne,
donc de son invisible universalité, qui avait fait irruption dans les consciences avec le néo-platonisme sous la forme d'un dieu entièrement
décorporé. Par conséquent, le dieu à nouveau incarné des chrétiens, en tant qu'il était censé posséder désormais non point une sorte de chair
divine, comme celle de Mars ou d'Aphrodite — chair dont les Grecs n'avaient d'ailleurs jamais précisé le statut philosophique —,
mais une chair proprement humaine, se trouvait dans l'impossibilité absolue de jamais se présenter comme un dieu doté d'une identité véritable
dans une culture grecque que plusieurs siècles de la pensée avaient convertie au règne spirituel de l'idée.
Il a donc fallu diviser l'identité
du dieu nouveau, donc de l'homme, en deux portions inconfusibles et déclarer divin le tronçon qui accomplissait les miracles, et humain celui
qui dormait, pleurait ou se montrait fatigué, à l'image des idoles antiques et du Jahveh primitif.
Mais, même ce dieu-là, de quelle identité
du sujet sera-t-il le dépositaire ? Comment empêcher que toute identité seulement charnelle soit fatalement en trompe l'oeil, puisque
l'intelligence, qui transcende le visible, le cloue nécessairement sur place et lui dit sans cesse :
« Je ne suis pas ici, j'habite un ailleurs ; je ne suis réellement vivant que dans l'au-delà de ce corps, dans l'au-delà de ce
monde physique ; l'universel est la véritable demeure de mon esprit » ?
Ce fut donc un casse-tête, pour les conciles de Nicée puis de Chalcédoine, de masquer la scission irrémédiable de l'identité de la personne
entre sa réalité corporelle et l'évasion de l'homme véritable hors de son propre corps, qui faisait le fond de la mystique et de la raison
platoniciennes.
En vérité, l'universel est l'arme mythifiée du pouvoir politique ; et le concept, le sceptre du commandement.
Comment diriger les hommes s'ils placent un « corps divin » au-dessus de l'idée, et s'ils retirent ainsi aux chefs l'outil de
l'invisible qu'est la pensée abstraite, bardée de principes et de lois ? La puissance descend, masquée par le langage généralisateur,
du mont Sinaï de l'universel vers les corps obéissants. Si l'autorité monte, tout au contraire, d'un corps sacré, les sommets de l'État
seront disqualifiés par le concret ; et les subordonnés seront tenus pour plus importants que les Olympes.
L'identité de l'autorité repose donc sur la sacralisation de l'universel. Il fallait empêcher une dévalorisation des ressources de la
dialectique qui eût été politiquement aussi catastrophique pour l'Église que pour l'État.
C'est pourquoi le grand rassemblement de tous les évêques de la chrétienté à Chalcédoine s'est vu contraint par Léon 1er,
qui avait la tête politique, de prendre définitivement acte de l'échec du voeu ardent qu'avait prononcé un autre rassemblement d'évêques
à Nicée cent vingt-cinq ans auparavant — celui de ne jamais commettre le sacrilège, alors jugé effroyable, de diviser l'identité
de la divinité, donc du sujet, en deux portions inconciliables.
Aussi, depuis quinze cents ans, l'homme d'Occident est-il déchiré entre l'abstrait, qui commande, et le concret, qui souffre,
le spirituel et le temporel, l'idéal et le réel,
et
,
comme le fait voir, avec un éclat sans pareil, le dieu irrémédiablement scindé qui symbolise l'identité à jamais fissurée de l'homme
en société.
« Je est un autre », dira
.
Le monde moderne vit dans la postérité intellectuelle de
;
car seul l'homme divisé entre son corps et son esprit peut faire progresser sa raison ; et un
unifié par le dogme, qui se contente de décréter une impossible alliance du corps avec l'esprit, n'est encore qu'un dieu grec fort primitif,
donc naïvement bivalent, sur lequel on a tenté en vain de greffer une divinité hébraïque déjà largement platonisée, mais non encore entièrement
décorporée.
La structure déhanchée de la conscience, dont l'impossibilité d'unifier le dieu est le symbole,
l'a mieux comprise que personne. Dans
,
un fonctionnaire, Ponza, partage ses dévotions entre deux femmes réunies en une seule, l'une toute temporelle, l'autre tout
imaginaire et toujours cachée sous un voile car son servant de mari la fait vivre en recluse. Elle joue visiblement, dans
l'esprit un peu dérangé du fonctionnaire, le rôle de la Vierge Marie pour les croyants, ou du marxisme pour les logiciens
de cette doctrine.
est l'humaniste de génie qui, ayant pris pleinement conscience du dédoublement de l'identité de la personne entre des symboles opposés qui fondent
ses jugements sur la valorisation tantôt de son identité principielle, tantôt de son identité corporelle, demande, après
:
« Quelle identité faut-il attribuer à ceux qui ont enfanté des signifiants métaphoriques universels de l'identité humaine,
donc les hiérarchies mêmes des valeurs, et qui voient l'homme toujours divisé entre la pierre de
du temporel et le feu d'un perpétuel élancement hors de toute enceinte ? »
L'appel qui l'empoigne, le comble, l'arme, le détruit, le brûle, l'assoiffe, le dessèche, le nourrit, le désaltère, le porte
aux nues est à la fois son tourment et sa grâce, son paradis et son enfer. Inapte à s'enfermer dans un empire délimité, un
savoir arrêté, un pouvoir circonscrit, l'identité de cet être n'est décidément pas assignable à résidence ; elle se
révèle invinciblement transcendante non seulement aux corps, mais encore aux victoires de l'esprit sur la chair, puisque
l'esprit les dénonce sans cesse comme illusoires à leur tour.
Sans relâche, l'homme se rouvre à la nuit qui le hante afin de retrouver sa désarrimante liberté.
Car l'universel n'est encore qu'un oracle insuffisant à nourrir la liberté et à lui donner un sens.
« Que vaut, dit l'homme, une évasion hors de mon corps, si cette évasion est enfermée d'avance dans les prestiges
de la pensée abstraite et de ses pouvoirs césariens ? Si l'universel n'est jamais que le temple des identités
collectives ? Si ces idoles nouvelles, et devenues cérébrales, sont seulement un peu moins grossièrement visibles
que celles qui promenaient autrefois effrontément leur corps ici-bas ? »
Mais, puisque l'intelligence, ambitieuse de cerner une identité fixe du sujet, est fondée sur son propre recul à l'infini,
donc sur sa transcendance, qui rejette au fur et à mesure les idoles arrêtées qu'elle pulvérise, du seul fait qu'elle les
capture, comment la course du sujet vers le néant où son identité s'évanouit dans l'insaisissable s'arrêterait-elle jamais ?
Dès qu'il s'agit de prendre conscience de la scission entre l'identité corporelle, qui se lie étroitement au sujet tangible, et celle
qui s'attache à l'ubiquité du langage, afin de distinguer clairement le concret du mental et le physique du psychique, l'identité
d'Adam ne demeure-t-elle pas plongée dans la même confusion entre ces deux ordres, parfaitement distincts, que celle dont la théologie
de l'incarnation d'un dieu, donc d'un esprit, demeure l'éloquent témoin ?
C'est qu'il s'agit toujours d'illustrer l'identité, désormais jumelée, des dominants et des dominés, ces derniers répétant
inlassablement le sacrifice d'amour et d'obéissance de l'individu à la collectivité sacralisée.
La Croix, puissant réflecteur cosmique de la structure civique de la conscience de soi, sera un
efficace, parce que l'identité dédoublée du dieu est adaptée d'avance aux crises essentielles qui peuvent se rencontrer dans l'histoire
des peuples. En effet, l'une des faces du dieu bifrons prêche sans relâche, par la bouche de
et de
,
la soumission obligatoire et pieuse des fidèles aux pouvoirs établis ; l'autre, au contraire, prêche la révolte des croyants,
chaque fois que l'Église se sentira menacée dans son identité. L'une exigera la capitulation sans conditions du sujet devant l'autorité,
à l'exemple du dieu innocent et pourtant livré à une exécution publique ; l'autre, la rébellion triomphale contre tous les Césars,
symbolisée par la résurrection.
Tout au long des siècles, la double identité de la personne, à la fois soumise et rebelle, victorieuse et sacrifiée,
a été si bien calquée sur les deux types de convulsions dont l'histoire offre le spectacle — les tyrannies et
les révolutions — qu'elle a été idéalement illustrée par un mythe théologique génialement conçu pour défendre
tour à tour une politique de l'auto-immolation de la créature à la puissance publique divinisée et une politique dite
de la libération qui retrouvait, dans la croix résurrectionnelle, l'élan des
et des
.
Quelle sera donc l'identité propre à la lucidité ? Quelle sera l'identité des
ou des
?
Le
sait parfaitement quelle est l'identité véritable de l'auteur de
:
« Il a écrit des oeuvres fort curieuses, empreintes d'un humanisme assez sombre, où l'homme apparaît comme un fantoche
incapable de se connaître lui-même. »
L',
en revanche, écrit :
« La valeur historique du théâtre de
est d'avoir servi de terrain de réflexion et de sujet d'imitation à plus de cinquante ans de théâtre mondial. »
On voit que le christianisme a été le plus puissant maître d'oeuvre de l'identité politique du sujet, donc du système des valeurs
qui fonde l'existence sociale, en symbolisant, par un récit mythique exemplaire, que le singulier devra toujours être sacrifié au
principiel et que c'est le groupe qui, en définissant la vérité, se subordonne l'individu.
|

![]() 1.
Identité et structure de l'esprit
1.
Identité et structure de l'esprit
![]()
![]() 3.
Le mythe, premier démiurge de l'identité culturelle
3.
Le mythe, premier démiurge de l'identité culturelle
![]()
![]() 4.
La structure transcendantale de la conscience identitaire
4.
La structure transcendantale de la conscience identitaire
![]()
![]() 5.
La scission de l'identité du sujet
5.
La scission de l'identité du sujet
![]()
![]() 6.
L'identité du sujet dans la démocratie
6.
L'identité du sujet dans la démocratie
![]()
![]() 8.
Théologie de l'identité démocratique
8.
Théologie de l'identité démocratique
![]()
![]() 9.
La nouvelle sacralisation de l'identité
9.
La nouvelle sacralisation de l'identité
![]()