
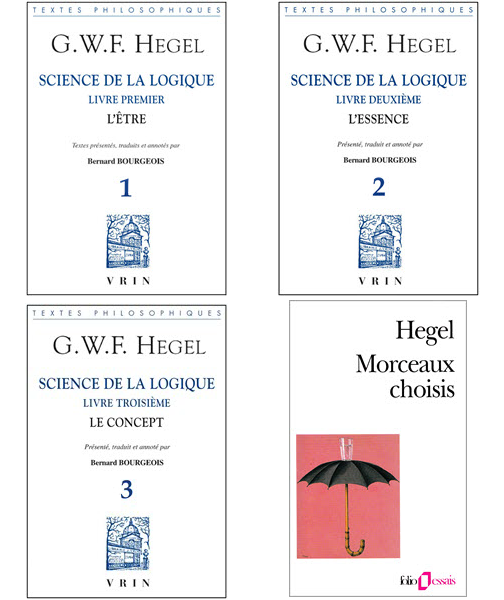
1812, 1813 et 1822
Démarche dialectique et historicisme
 |
|
||||
|
|
|||||
|
1812, 1813 et 1822 |
|||||
|
Démarche dialectique et historicisme |
|||||
|
SOMMAIRE |
|||||
|
|
|
Être, Néant et Devenir [1] A. — L'ÊTRE Être, Être pur, sans aucune autre détermination. Dans son immédiateté indéterminée, il n'est égal qu'à lui-même, sans être inégal à autre chose : il est exempt de toute différence aussi bien par rapport à son intérieur que par rapport à l'extérieur. Lui attribuer une détermination ou un contenu qui créeraient une différenciation en son propre sein ou le différencieraient de choses extérieures, ce serait lui enlever sa pureté. Il est l'indétermination pure et le vide pur. Il n'y a rien à contempler en lui, si toutefois il peut être question à son propos de contemplation, à moins que ce soit de contemplation pure et vide. Il n'y a rien non plus à penser à son sujet, car ce serait également penser à vide. L'être, l'immédiat indéterminé, est en réalité Néant, ni plus ni moins que Néant. B. — LE NÉANT Néant, le pur Néant ; c'est la simple égalité avec soi-même, le vide parfait, l'absence de détermination et de contenu ; l'indifférenciation au sein de lui-même. Pour autant qu'il puisse être question ici de contemplation ou de pensée, c'est seulement au point de vue de la différence qu'il y a entre contempler ou penser quelque chose et contempler ou penser rien. Contempler ou penser rien a donc une signification ; nous faisons une différence, sous ce rapport, entre quelque chose et rien, d'où il résulte que celui-ci est (existe) bien dans notre contemplation et notre pensée ; ou plutôt, il est la contemplation et la pensée vides elles-mêmes, la même contemplation ou pensée vides que l'être vide. Le Néant représente donc la même détermination ou, plutôt, la même absence de détermination que l'être pur. C. — LE DEVENIR L'être pur et le néant pur sont donc la même chose. Ce qui est vrai, ce ne sont ni l'être ni le néant, mais le passage, et le passage déjà effectué, de l'être au néant et de celui-ci à celui-là. Mais il est tout aussi vrai que, loin d'être indistincts, loin d'être la même chose, l'être et le néant diffèrent absolument l'un de l'autre, tout en étant inséparés et inséparables, chacun disparaissant directement dans son contraire. Leur vérité consiste donc dans ce mouvement de disparition directe de l'un dans l'autre : dans le devenir ; mouvement qui, en même temps qu'il fait ressortir leur différence, la réduit et la supprime. NOTE 1 On oppose généralement le Néant à quelque chose : « quelque chose » est un existant défini, qui diffère d'un autre « quelque chose » ; de même, le Néant opposé au « quelque chose », est le néant de quelque chose, un Néant défini. Mais ici le Néant doit être pris dans sa simplicité indéterminée. Si l'on estime qu'il est plus correct d'opposer à l'être, au lieu du néant, le non-être, il n'y a rien à objecter à cela au point de vue du résultat, car le non-être implique le rapport à l'être ; les deux, l'être et sa négation, sont exprimés à la fois : le néant en voie de devenir. Mais il s'agit, avant tout, non de la forme de l'opposition, c'est-à-dire du rapport, mais de la négation abstraite, directe, du néant pur, de la négation n'impliquant aucun rapport, ce que l'on peut, si l'on veut, exprimer par le simple : non. Les Éléates, et plus particulièrement Parménide, voyaient dans la simple pensée de l'être pur l'Absolu et la seule vérité ; et dans ses fragments qui nous sont parvenus, se trouve exprimée pour la première fois, dans son abstraction absolue et avec l'ardeur d'un pur enthousiasme intellectuel, cette pensée : seul l'être est, le Néant n'existe pas. Le Néant, le vide constitue, on le sait, le principe absolu de systèmes orientaux, principalement du bouddhisme. Le profond Héraclite a opposé à cette abstraction simple et unilatérale le concept total et supérieur du devenir, en disant : l'être n'est pas plus (de chose) que le Néant, ou encore : tout coule, ce qui équivaut à dire : tout est en voie de devenir, tout devient. Les sentences populaires, surtout orientales, d'après lesquelles tout ce qui est contient du fait même de sa naissance, les germes de sa disparition, tandis que la mort ne serait que l'entrée dans une vie nouvelle, expriment au fond la même unité de l'être et du non-être. Mais ces expressions ont un substrat sur lequel s'effectue le passage ; l'être et le néant sont séparés dans le temps, sont pensés comme alternant, et non comme étant en soi une seule et même chose. |
|||||
|
Contradiction [2] Livre 3, p. 67 Mais un des principaux préjugés de la Logique, telle qu'elle a été comprise jusqu'ici, et de la représentation, consiste à voir dans la contradiction une détermination moins essentielle et immanente que l'identité ; alors que s'il pouvait ici être question de hiérarchie et s'il fallait persister à maintenir ces deux déterminations isolées l'une de l'autre, c'est plutôt la contradiction qui serait la détermination la plus profonde et la plus essentielle. C'est que l'identité est, comparativement à elle, détermination du simple immédiat, de l'Être mort ; mais elle, la contradiction, est la racine de tout mouvement et de toute manifestation vitale ; c'est seulement dans la mesure où elle renferme une contradiction qu'une chose est capable de mouvement, d'activité, de manifester des tendances ou impulsions. Livre 3, p. 68 [...] Mais c'est un fait d'expérience courante qu'il y a une foule de choses contradictoires, d'institutions contradictoires, etc., dont la contradiction n'a pas seulement sa source dans la réflexion extérieure, mais réside dans les choses et les institutions elles-mêmes. Elle ne doit pas non plus être considérée comme une simple anomalie qui s'observerait ici ou là, mais elle est le négatif d'après sa détermination essentielle, elle est le principe de tout mouvement spontané, lequel n'est pas autre chose que la manifestation de la contradiction. [...] [...] sous un seul et même rapport une chose existe en-soi et est en même temps son propre manque ou négatif. L'abstraite identité à soi ne correspond encore à rien de vivant, mais, du fait que le positif est par lui-même négativité, il sort de lui-même et s'engage dans le changement. Une chose n'est donc vivante que pour autant qu'elle renferme une contradiction et possède la force de l'embrasser et de la soutenir. Concept [3] Livre 2, p. 203 [...] un examen plus approfondi de la nature antinomique ou, plus exactement, dialectique de la raison montre généralement que chaque concept constitue une unité de moments opposés auxquels on pourrait par conséquent donner également la forme d'affirmations antinomiques. Devenir, existence, etc., bref, n'importe quel concept peut ainsi révéler des antinomies qui lui sont propres, et l'on pourrait en conséquence établir autant d'antinomies qu'il y a de concepts. [...] Livre 2, p. 204 [...] [...] La seule vraie solution ne peut consister qu'en ce que les deux déterminations, tout en étant opposées et parties nécessaires d'un même concept, soient considérées, non dans ce qu'elles ont d'unilatéral, chacune pour elle-même, mais comme ayant leur vérité dans leur suppression, dans l'unité de leur concept. |
|||||
|
Triade dialectique [4] Aristote a exprimé d'une façon tout à fait définie le sens de cette trinité. Ce qui est parfait, ce qui a de la réalité, l'a dans la trinité : commencement, milieu, fin. Le principe est le simple ; le milieu, son être autre (la dyade, l'opposition) ; l'unité (Esprit), la fin ; le retour de son être autre dans cette unité. Chaque chose est : a) être, simple ; b) différence, diversité ; c) unité des deux, unité dans son être autre. Sans cette trinité, la chose est détruite, elle devient une fiction imaginée, une abstraction. |
|||||
|
Chaque philosophie est vraie et fausse [5] Toutes les philosophies sont vraies et fausses ... on n'a réfuté aucune philosophie. Ce qu'on a réfuté ce n'est pas le principe d'une philosophie donnée, mais seulement la notion que ce principe est ultime, qu'il est la détermination absolue. |
|||||
|
À quoi sert la philosophie ? [6] Le but ultime, l'intérêt de la philosophie, est de concilier la pensée et le concept avec l'actualité. La philosophie est la véritable théodicée, plus haute que l'art et la religion et leurs impressions, — la réconciliation de l'Esprit avec lui-même, de l'Esprit qui s'est saisi dans sa liberté et dans la richesse de son actualité. Il est d'ailleurs facile de trouver satisfaction dans des positions subordonnées, dans l'intuition ou le sentiment. Plus l'Esprit descend profondément en lui-même, plus forte est l'opposition ; la profondeur doit être mesurée selon la grandeur de l'opposition, — du besoin ; plus profondément il est descendu en lui, plus profond est son besoin de chercher au-dehors, de se trouver ; plus étendue est sa richesse extérieure. Ce qui existe comme nature actuelle est l'image de la raison divine ; les formes de la raison consciente de soi sont aussi formes de la nature. Nature d'un côté, — monde de l'Esprit et histoire, de l'autre, — sont les deux actualités. Nous avons vu apparaître la pensée qui se saisit elle-même ; elle tendait à se faire concrète. Sa première activité est formelle ; c'est seulement Aristote qui proclame le Noüs ; comme pensée de la pensée. Le résultat est la pensée qui est pour soi et qui en même temps embrasse l'univers, le transforme en monde intelligent. Dans l'intellection l'univers naturel et le spirituel s'interpénètrent comme un univers harmonieux [...]
La dernière philosophie est le résultat de toutes les précédentes ; rien n'est perdu, tous les principes sont conservés.
Cette Idée concrète est le résultat des efforts de l'Esprit depuis bientôt 2 500 ans
(Thalès
naquit en 640 avant Jésus-Christ), — de son travail le plus sérieux, pour être objectif pour lui-même, pour se connaître :
[...] Ce travail de l'Esprit pour se connaître, cette activité est l'Esprit, la vie même de l'Esprit. Son résultat est le concept qu'il conçoit de lui-même ; l'histoire de la philosophie connaît clairement que l'Esprit a voulu cela dans son histoire. Ce travail de l'Esprit humain dans la pensée intérieure est parallèle avec tous les degrés de la réalité. Aucune philosophie ne va au-delà de son époque. L'histoire de la philosophie est l'élément le plus intérieur de l'histoire universelle [...] |
|||||
|
Histoire de la philosophie : aperçu général [7] Les époques principales de toute l'histoire de la philosophie, la suite nécessaire des stades, des moments principaux peut se résumer ainsi. Après l'ivresse de la subjectivité orientale qui n'atteint pas l'entendement, — donc qui reste sans stabilité — la lumière de la pensée se fit jour en Grèce [...] La philosophie des Anciens pensa l'Idée absolue, et la réalisation ou la réalité de cette Idée consista à comprendre et à considérer le monde actuel tel qu'il était en et pour soi. 1. Cette philosophie ne partit pas de l'Idée elle-même, mais de l'objectivité comme donnée, et transforma celle-ci en Idée : — l'Être. 2. La pensée abstraite, le Noüs, se connut comme essence universelle, comme Pensée — non comme pensée subjective, ce fut l'Universel de Platon. 3. Avec Aristote apparaît le concept, pensée libre, candide, conceptuelle, traversant et spiritualisant toutes les formes de l'univers. 4. Le concept comme sujet, son devenir pour soi, son être interne, — la séparation abstraite, — ce furent les stoïciens, les épicuriens, le scepticisme : non pas forme concrète libre, mais abstraite universalité formelle. 5. L'idée de Totalité, le monde intelligible, le monde comme monde d'idées, c'est l'Idée concrète, telle que nous l'avons vue chez les néoplatoniciens. Ce principe est l'idéalité abstraite dans toute la réalité, l'Idée comme totalité, mais non l'Idée se connaissant elle-même, — jusqu'au moment où le principe de la subjectivité, de l'individualité la pénétra et où Dieu en tant qu'Esprit devint actuel pour soi dans la conscience de soi. 6. Mais l'oeuvre des temps modernes consiste à saisir cette Idée comme Esprit, comme Idée se connaissant elle-même. Pour accomplir ce progrès de l'Idée connaissante à l'Idée se connaissant, il faut l'opposition infinie, il faut que l'Idée parvienne à la conscience de sa scission absolue. Ainsi la philosophie acheva l'intellectualité du monde, lorsque l'Esprit pensa l'essence objective ; elle produisit ce monde spirituel comme un objet existant au-delà du présent et de l'actuel — comme une nature, — première création de l'Esprit. À partir de ce moment, le travail de l'Esprit consista seulement à ramener cet « au-delà » dans l'actuel et dans la conscience de soi. Cela est accompli par le fait que la conscience de soi se pense elle-même et reconnaît l'être suprême (l'essence absolue) comme conscience de soi qui se pense elle-même. Avec Descartes la pensée pure émergea de cette scission. La conscience de soi se pense d'abord comme conscience ; toute réalité objective y est contenue, ainsi que le rapport positif, intuitif de sa réalité avec l'autre. La pensée et l'être sont opposés et identiques dans Spinoza ; il a l'intuition substantielle, la connaissance externe. Le principe de la conciliation, à partir de la pensée comme telle, le dépassement de la subjectivité de la pensée se découvre alors — dans la monade pensante de Leibniz. 7. En second lieu, la conscience de soi pense qu'elle est conscience de soi, être pour soi, mais encore dans un rapport négatif avec l'Autre. C'est la subjectivité fichtéenne : a) comme critique de la pensée, b) comme impulsion vers le concret. La forme infinie absolument pure est exprimée : conscience de soi, Moi. 8. Cet éclair traverse la substance spirituelle, et ainsi le contenu absolu et la forme absolue sont identiques ; — la substance est identique intérieurement avec la connaissance. En troisième lieu, la conscience de soi reconnaît alors son rapport positif comme son négatif, et son négatif comme son positif, — autrement dit, elle reconnaît ces activités opposées comme une et même, c'est-à-dire la pensée pure ou l'être comme l'identité avec soi, et celle-ci, comme la scission. C'est l'intuition intellectuelle ; mais pour qu'elle soit vraiment intellectuelle, on exige qu'elle ne soit pas immédiatement cette intuition de l'éternel et du divin, comme on dit, mais absolument connaissante. Cette intuition qui ne se connaît pas elle-même est le commencement dont on part comme d'une présupposition absolue ; elle est ainsi seulement intuitive, connaissance immédiate, non connaissance de soi : autrement dit elle ne connaît rien ; ce qu'elle intuitionne n'est pas connu ; il s'agit dans le meilleur cas, de belles pensées, non de connaissances. L'intuition intellectuelle est connue : a) quand les opposés (toute réalité externe et interne) sont connus chacun en tant que séparé de l'autre. Si elle est connue selon sa nature, telle qu'elle est, elle se révèle comme non subsistante — son essence est le mouvement de transition. Cet élément héraclitéen ou sceptique, ce fait que rien n'est immobile, doit être montré dans chaque réalité ; ainsi apparaît dans cette conscience (l'essence de chaque réalité étant détermination, étant son opposé) l'unité conçue avec son contraire ; b) cette unité est également à connaître dans sa nature ; son essence comme cette identité doivent aussi passer dans leur contraire, se réaliser, devenir autre ; ainsi son opposé apparaît par elle-même ; c) de nouveau, il faut dire de l'opposition qu'elle n'est pas dans l'absolu. Cet absolu est l'être suprême, l'éternel, etc. Mais ceci est encore une abstraction, un aspect seulement [...] La pensée pure progressa jusqu'à l'opposition du subjectif et de l'objectif ; et la véritable conciliation de l'opposition est cette connaissance que poussée à l'extrême, cette opposition se résout elle-même, — qu'en soi, comme dit Schelling, les opposés sont identiques et non seulement en soi, mais que la vie éternelle consiste précisément à produire éternellement l'opposition et à la concilier éternellement. Connaître l'unité dans l'opposition, et dans l'opposition, l'unité, c'est le savoir absolu ; et la science philosophique consiste à connaître cette unité dans tout son développement par elle-même. * * * Le résultat général de l'histoire de la philosophie est ainsi : 1. qu'il y eut toujours une seule philosophie dont les différences simultanées sont les aspects nécessaires du principe unique ; 2. que la suite des systèmes philosophiques n'est pas accidentelle, mais qu'elle représente la suite nécessaire des stades dans le développement de la philosophie ; 3. que la philosophie ultime d'une époque est le résultat de ce développement, la forme suprême de la vérité que la conscience de soi de l'Esprit se donne sur elle-même. La dernière philosophie contient donc toutes les précédentes, comprend en soi tous les degrés ; elle est produit et résultat de toutes les précédentes. On ne peut pas à notre époque être platonicien, on doit s'élever au-dessus : a) des petitesses des opinions particulières, des pensées, des objections, des difficultés ; b) de sa propre vanité, comme si on pouvait penser quelque chose de particulier. Saisir l'esprit interne, substantiel, c'est cela la position de l'individu ; à l'intérieur du tout, les individus sont comme des aveugles, l'Esprit interne les pousse. |
|||||
|
Liberté et nécessité [8] Chaque système est à la fois un système de la liberté et de la nécessité. Liberté et nécessité sont des facteurs idéels, donc non réellement opposés ; l'absolu ne peut se poser comme absolu dans aucune de ces deux formes, et les disciplines philosophiques ne peuvent pas être, l'une un système de la liberté, l'autre un système de la nécessité. Une telle liberté séparée serait une liberté formelle ; de même une nécessité séparée serait une nécessité formelle. La liberté est un caractère de l'absolu posé comme interne [...] La nécessité est un caractère de l'absolu en tant qu'il est considéré comme externe, comme totalité objective, donc comme une juxtaposition aux parties de laquelle aucun être n'est attribué si ce n'est dans le tout de l'objectivité. Étant donné que l'intelligence et la nature, par le fait d'être posés dans l'absolu, ont une opposition réelle, les facteurs idéals de la liberté et de la nécessité sont attribués à chacune d'elles — Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems [Différence entre les systèmes de Fichte et de Schelling]. |
|||||
|
[1]
Hegel, Science de la logique (1812), Logique de l'être
(Tome 1), (Livre 1 de 4), Aubier © 1971,
p. 72-74,
[2]
Hegel, Science de la logique (1813), Logique de l'essence
(Tome 3), (Livre 3 de 4), Aubier © 1971,
p. 67-68,
[3]
Hegel, Science de la logique (1812), Logique de l'être
(Tome 2), (Livre 2 de 4), Aubier © 1971,
p. 203-204,
[4]
Hegel, Cours d'histoire de la philosophie (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (G. P.)),
G. P., 258. [5] Ibid, G. P., 51. Extrait de Ibid., p. 612. [6] Ibid, G. P., III, 684-686. Extrait de Ibid, p. 619-620. [7] Ibid, G. P., III, 686-691. Extrait de Ibid, p. 620-624. [8] Hegel, Erste Druckschriften (Oeuvres de Jeunesse), E. D., 86-87. Extrait de Ibid, p. 614.
|
|||||