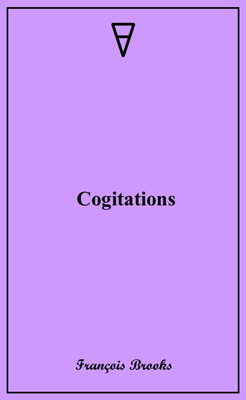2025-07-10
Hegel décrypté
SOMMAIRE
 |
||||
|
2025-07-10 |
||||
|
Hegel décrypté |
||||
|
SOMMAIRE |
||||
|
Confusion dialectique et Liberté nébuleuse
Hegel, Science de la logique, 1812.
Mais où diable Hegel a-t-il formulé le principe et dans quels termes ? En fait, il ne l'a jamais formulée ainsi dans ses propres écrits. Cette triade est une reconstruction pédagogique, popularisée par ses commentateurs, notamment Fichte et plus tard Marx, pour résumer la dialectique hégélienne. Les termes propres au philosophe sont : Être / Néant => Devenir. Hegel fut si nébuleux que Schopenhauer l'a vertement critiqué :
[...]
Schopenhauer, Contre la philosophie universitaire, 1851. Nous savons que les cours de Hegel étaient très fréquentés alors que ceux de Schopenhauer ne comptaient pas beaucoup plus qu'une dizaine d'auditeurs. Les mauvaises langues penseront qu'il n'était qu'un collègue jaloux. Mais un instant ! comment ne pas lui donner raison après avoir lu ceci ? : Chaque système est à la fois un système de la liberté et de la nécessité. Liberté et nécessité sont des facteurs idéels, donc non réellement opposés ; l'absolu ne peut se poser comme absolu dans aucune de ces deux formes, et les disciplines philosophiques ne peuvent pas être, l'une un système de la liberté, l'autre un système de la nécessité. Une telle liberté séparée serait une liberté formelle ; de même une nécessité séparée serait une nécessité formelle. La liberté est un caractère de l'absolu posé comme interne [...] La nécessité est un caractère de l'absolu en tant qu'il est considéré comme externe, comme totalité objective, donc comme une juxtaposition aux parties de laquelle aucun être n'est attribué si ce n'est dans le tout de l'objectivité. Étant donné que l'intelligence et la nature, par le fait d'être posés dans l'absolu, ont une opposition réelle, les facteurs idéals de la liberté et de la nécessité sont attribués à chacune d'elles. Hegel, Erste Druckschriften (Oeuvres de Jeunesse), E. D., 86-87. Qu'est-ce qu'il dit ?? Hegel explique ici tout ce qu'il faut savoir pour se dépatouiller de l'éternelle question, à savoir : est-ce que l'homme est véritablement libre alors que partout, on le retrouve enchaîné à des circonstances qui montrent que l'on agit sans comprendre les influences qui nous déterminent ? Comment peut-on affirmer que l'on dispose du libre arbitre alors que les circonstances nous poussent à agir involontairement ? Freud a inventé un subtil système psychanalytique pour creuser l'inconscient en martelant que la conscientisation apporterait à l'homme la liberté tant recherchée. Dans l'Antiquité, la question était déjà traitée par Épictète qui avait statué que certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Au XXe siècle, Sartre postulait sine qua non que l'essence même de l'humain est la liberté — autrement dit, on ne peut se considérer humain que si l'on assume le postulat que nous sommes libres et responsables. Alors donc, sommes-nous libres ou bien déterminés dans nos actions ? |
|||||
|
Personnellement, à l'instar de Bergson, j'ai tendance à concevoir la chose selon le simple schéma temporel : passé / présent / futur.
Ce qui est passé est déterminé, et l'on peut retracer la destinée, a posteriori, en remontant la cascade des causes qui ont déterminé tous les événements comme les dominos qui déboulent aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps jusqu'au Premier moteur immobile d'Aristote — que les théologiens appellent le Dieu Créateur. On ne peut pas changer le passé ; il est déterminé par une suite de causes que la raison peut retracer. D'autre part, il me semble que la liberté n'est possible que pour l'avenir. On peut à tout moment prendre une décision volontaire qui résiste aux contingences pour choisir l'avenir. Aristote parlait de « cause finale ». Si l'on pense être libre, c'est donc que nous sommes en mesure de planifier l'avenir avec nos souhaits en vue de la finalité désirée. Pourtant, nous ne sommes que des êtres actuels logés dans des corps vivants. Nous sommes influencés par le passé ; nous influençons l'avenir, mais nous sommes encastrés dans un présent perpétuel. Augustin l'a pertinemment observé. Nous n'avons accès au passé que par les traces qui subsistent dans la mémoire actuelle ; et nous n'avons accès à l'avenir que par la volonté qui tente de le prédire par les actions présentes intentionnelles. |
|||||
|
Déchiffrage : Sommes-nous libres ou bien déterminés ? Mais ce beau raisonnement décrit une situation qui ne résout pas l'énigme. Sommes-nous libres ou bien déterminés ? Et si nous sommes l'un et l'autre, dans quelle mesure ? Selon les époques, les courants de pensée nous entraînent dans un sens ou l'autre. La mode idéologique actuelle ne cesse de répéter que nous sommes libres et maîtres de notre destinée. Pour peu, on serait collectivement responsables de la vitesse de rotation de la Terre — apparemment, le barrage des Trois Gorges en Chine l'aurait ralentie. Pourtant, le premier venu reconnaîtra qu'il a du mal à contrôler son emploi du temps. Hegel propose ici une solution lumineuse cachée dans des termes si nébuleux et soporifiques ; comment le déchiffrer ? D'abord, le texte est d'une densité impressionnante. Il condense tout ce qui a pu être dit sur la liberté et la destinée depuis que les philosophes ont examiné la question. Il fait référence à une dizaine de concepts qu'il faut d'abord maîtriser :
Qu'est-ce que la liberté ? Ces concepts furent triturés par de nombreux philosophes de telle sorte que, de l'un à l'autre, ils prennent souvent des significations différentes et apparaissent dans des perspectives plus ou moins novatrices. Bref, Hegel, bien qu'il soit ici traduit dans un français fidèle à sa pensée, donne l'impression de parler une autre langue. Chaque philosophe laisse une trace originale dans les concepts qu'il touche. Essayons de déchiffrer les galimatias de Hegel. Commençons par enlever l'intimidant piédestal. La langue est le meilleur moyen que l'homme a trouvé pour communiquer à travers les siècles. Mais elle est en constante mutation. Chaque génération détourne le sens des mots pour se l'approprier si bien que l'on a souvent l'impression que les jeunes s'inventent un langage privé. On n'est pas plus intelligent lorsque l'on parle une langue inconnue ; on est seulement plus familier avec un groupe distinct. Hegel parle la langue philosophique, et, en respectant le sens convenu des mots, il le détourne aussi pour montrer quelque chose d'inusité. Les mots sont fixes, mais les significations sont aussi mobiles que la vie.
Pourquoi ? Parce que le monde est ce qu'il est. La raison humaine n'est qu'un moyen de le représenter. Distinguer les choses en leur assignant des étiquettes qui les pairent en complémentarités opposées est une vision commode de la raison. Mais peut-on réduire le monde à deux chiffres : zéro et un ? En fait, c'est lorsque le monde est représenté de la façon la plus simple qu'il devient incompréhensible. Hegel a certainement proposé une perspective fascinante, mais le concept dialectique de « Être / Néant => Devenir » est une simplification qui apporte autant de confusion que d'éclaircissement. Pourquoi ? Parce que le monde est ce qu'il est. La pensée finit toujours par boucler sur la répétition qui n'explique rien, mais crée la confusion. On croit comprendre alors que nous bouclons sur la répétition comme la prière fabrique la réalité. Au bout du compte, liberté et destinée ne sont que des perspectives de la raison. Chacun s'en arrange comme il veut — ou comme il peut. Mais Hegel montre qu'il est impossible de parler de l'un sans conceptualiser l'autre. Comme le yin et le yang, ils sont entrelacés indéfectiblement ; ils fondent ce qui permet à la raison binaire de comprendre le monde. Parménide a montré que le monde de la raison est fixe, stable, aussi immobile que le oui est toujours le oui et le non reste toujours le non. Héraclite a montré au contraire que tout est en mouvement, et la réalité prouve à chaque instant qu'il est impossible de se baigner deux fois dans le même fleuve. Hegel a proposé le concept qui permet d'accommoder les deux perspectives. C'est certainement parce qu'elles sont inconciliables que ses textes nous engouffrent dans la confusion. |
||||
|
|
||||